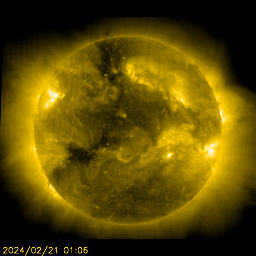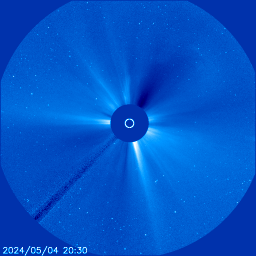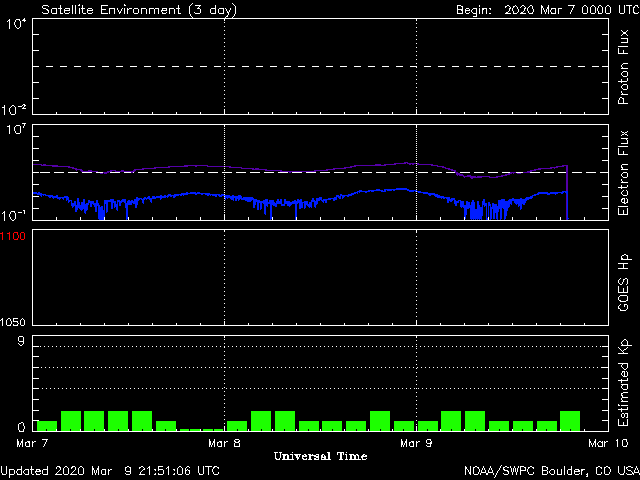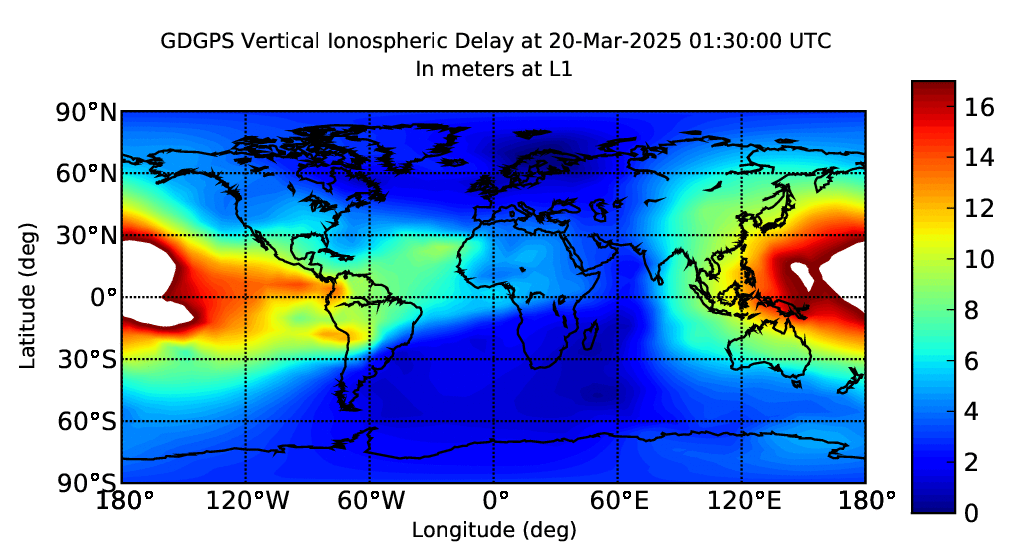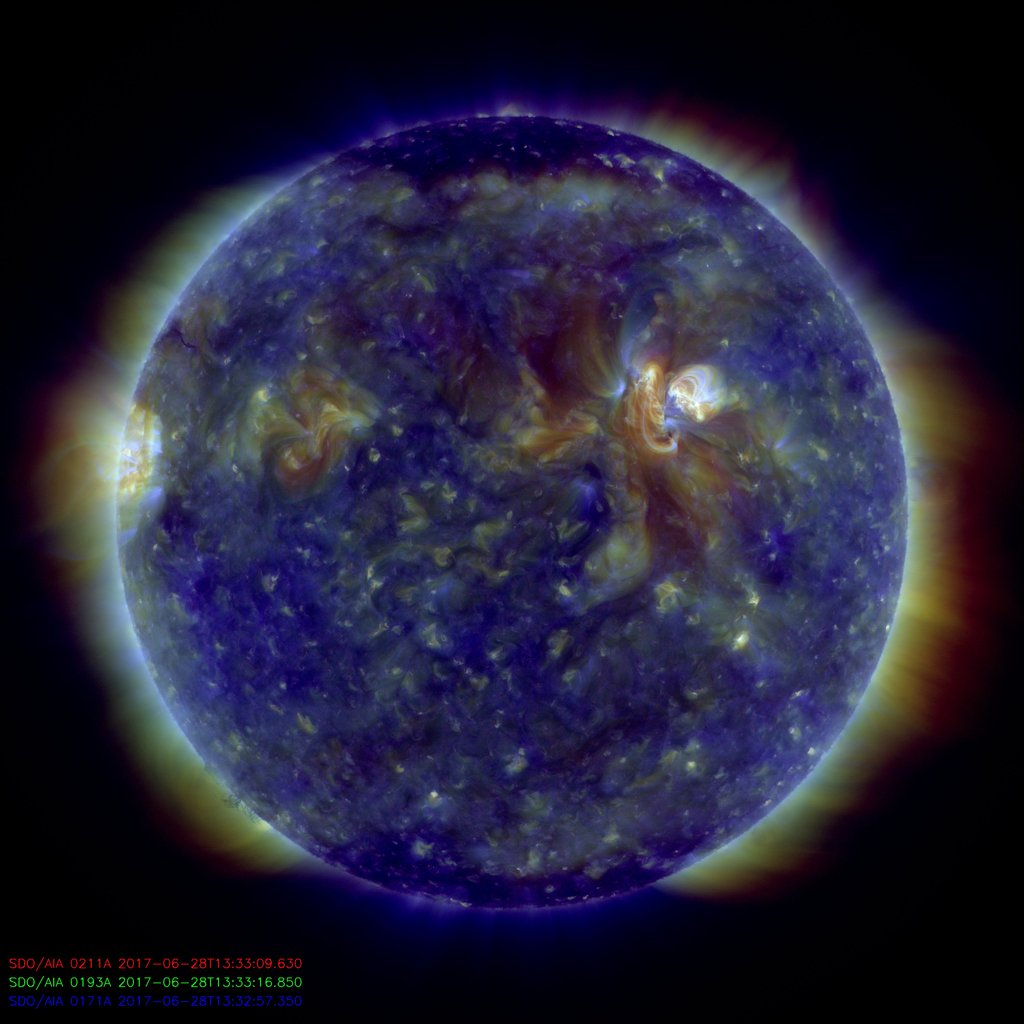Guerre du Viêt Nam - Le secret des armes
DOCUMENTAIRES CONTRE UNE « SALE GUERRE »
Filmer le conflit du Vietnam
IL y a vingt-cinq ans, le 30 avril 1975, s’achevait la guerre du Vietnam. Long et meurtrier, ce conflit devait se terminer par un humiliant retrait du corps expéditionnaire américain. A l’occasion de cet anniversaire, les télévisions du monde vont sans doute reprogrammer les principaux films de fiction inspirés par la conflagration : Deer Hunter, Platoon, Apocalypse Now, Full Metal Jacket... Mais quelle chaîne songera à proposer les admirables documentaires qui, mieux que les longs-métrages de fiction, témoignèrent de l’exceptionnelle cruauté d’un affrontement qui causa la mort de 58 000 Américains et de plus de 3 millions de Vietnamiens ?
Par Ignacio Ramonet
La guerre du Vietnam dura quatorze ans, de 1961 à 1975. Le Front de libé ration du Sud-Vietnam se constitua le 20 décembre 1960, environ six semaines après l’élection aux Etats-Unis de John F. Kennedy. Dès le début de l’année suivante, celui-ci jeta les Forces spéciales dans la guerre, en violation des accords de Genève de 1954. Puis ce fut l’escalade décidée par Lyndon B. Johnson, à la fin des années 60, avec le bombardement du Nord et de Hanoï. Il y eut ensuite la « vietnamisation » de la guerre décidée par Richard Nixon. Enfin, le gouvernement proaméricain de Saigon et son armée s’effondrèrent le 30 avril 1975.
Ce conflit a été le thème le plus longuement traité par la télévision dans toute l’histoire des informations télévisées américaines. Une étude très précise a été effectuée par le sociologue George Bayley (1) sur la manière dont les trois grands réseaux américains (ABC, CBS, NBC) rendirent compte de cette guerre durant la période 1965-1970.
Presque la moitié des informations sur la guerre concernaient soit les actions de l’infanterie sur le terrain, soit les activités de l’aviation ; et environ 12 % d’entre elles étaient des déclarations officielles des deux gouvernements (Saigon et Washington). Le point de vue de l’« ennemi » n’était fourni que par 3 % de l’ensemble des informations diffusées. Un tel pourcentage indique assez explicitement combien la télévision américaine fut partiale.
L’impact de cette guerre aux Etats-Unis et le refus qu’elle suscita auprès des jeunes notamment - manifestations antibellicistes, marches pour la paix, protestations universitaires - furent également minimisés. A propos de cette partialité, George Bayley note : « A peu près tous les résumés quotidiens des combats provenaient des services de relations publiques de l’armée. » Ces services avaient dépensé, pour la seule année 1971, plus de 200 millions de dollars dans le but de proposer aux citoyens américains la meilleure image possible de l’armée.
Dans un documentaire de Peter Davis, The Selling of the Pentagon (« Comment on vend le Pentagone »), un ancien officier des services d’information raconte comment il s’efforçait de « désinformer » les journalistes venus enquêter sur le terrain. Par exemple, une équipe de la CBS qui réalisait un reportage sur les bombardements du Vietnam du Nord et s’était adressée à lui pour trouver des pilotes américains à interroger fut victime de ses manipulations. Il lui fournit effectivement des pilotes, mais après avoir sévèrement chapitré ceux-ci sur ce qu’il ne fallait surtout pas dire...
« De la même façon, note un observateur, les services d’information montaient des opérations bidons de troupes gouvernementales sud-vietnamiennes. Elles étaient filmées par les services officiels, qui envoyaient ensuite les reportages aux petites stations américaines qui n’avaient pas les moyens d’envoyer des équipes au Vietnam (2). »
C’est pour s’opposer à cette vision partiale et manipulatrice d’une « sale guerre » que des cinéastes indépendants entreprirent, dès la fin des années 60, de dénoncer, au moyen de documentaires politiques, les horreurs et les crimes de l’intervention américaine au Vietnam.
« Au nom de la civilisation occidentale »
DANS In the Year of the Pig (« Vietnam, année du cochon »), en 1969, Emile de Antonio tenta, le premier, d’expliquer les raisons profondes de la guerre. Avec des méthodes d’archéologue, Antonio étudia une énorme quantité d’images d’archives, depuis l’époque de la colonisation française, et démontra deux choses : la préméditation de l’intervention américaine et le caractère, selon lui, inéluctable de la défaite militaire.
Les signes avant-coureurs de cet échec, un cinéaste de génie, Joseph Strick, les avait déjà repérés (cf. son film Interviews with My Lai Veterans, 1970) dans la crânerie et la suffisance qu’affichaient le lieutenant Calley et ses sinistres compagnons, soldats transformés, par la grâce de l’armée, en criminels de guerre, véritables machines de mort, après avoir subi les entraînements déshumanisants que le documentariste Frédéric Wiseman avait dénoncés dans Basic Training en 1971.
L’insoumission fut réclamée par le poignant Winter Soldier (« Soldat d’hiver »), documentaire collectif où des vétérans de la guerre témoignent des atrocités qu’eux-mêmes, « au nom de la civilisation occidentale », ont commises au Vietnam. Ce film est sans doute, de tous les documentaires réalisés contre la guerre du Vietnam, celui dont l’impact auprès de l’opinion publique a été le plus fort.
De jeunes « vétérans » (ils ont entre vingt et vingt-sept ans) prennent conscience, au retour de la guerre, qu’ils ont participé à une boucherie et que, en raison du conditionnement subi, ils ont été déshumanisés et réduits à l’état de « Terminator » criminels. Ils comprennent alors que la guerre du Vietnam n’aura jamais son Tribunal pénal international, que les vrais responsables politiques et militaires des massacres, du napalm répandu, des bombardements aériens contre les civils, des exécutions massives dans les bagnes, et des désastres écologiques provoqués par l’usage massif de défoliants ne passeront jamais devant une cour martiale et ne seront jamais condamnés pour crimes contre l’humanité.
Cette évidence leur devient insupportable ; aussi, afin d’apporter un contre-témoignage aux mensonges répandus par les médias, cent vingt-cinq d’entre eux, ni insoumis ni déserteurs, souvent couverts de décorations, se réunissent à Detroit, en février 1971. Des cinéastes de New York décident de filmer cet événement que les médias officiels boycottent. Ils enregistrent trente-six heures de film dont Winter Soldier est la synthèse.
On y voit ces anciens soldats, naguère fiers d’avoir combattu pour leur patrie, expliquer le décervelage préalable subi dans les camps d’entraînement où on leur apprenait à museler leur conscience morale et à libérer leurs instincts d’agression. Ils racontent les atrocités qu’ils commirent une fois leur robotisation achevée : les viols, les tortures, les villages incendiés, les exécutions sommaires, les enfants pris pour cible, les oreilles des Vietnamiens (vivants ou morts) échangées contre des boîtes de bière, les prisonniers jetés du haut des hélicoptères, etc.
Ils évoquent le catalogue de consignes au nom desquelles était conduite la guerre : « Un Vietnamien vivant, c’est un suspect vietcong ; un Vietnamien mort, c’est un véritable vietcong », « Si un paysan s’enfuit à votre approche, c’est un vietcong ; s’il ne s’enfuit pas, c’est un vietcong intelligent ; dans les deux cas, il faut l’abattre », « Comptez les prisonniers seulement à l’arrivée de l’hélicoptère, pas au départ, vous n’aurez pas à rendre compte de ceux qui seraient tombés en vol », etc.
Winter Soldier met en évidence la profondeur du traumatisme provoqué aux Etats-Unis par le conflit et souligne le désarroi moral de la jeunesse engagée au Vietnam.
Plus tard, le réalisateur Peter Davis s’est interrogé, dans Hearts and Minds (« Les Coeurs et les Esprits »), en 1973, sur les traits culturels américains qui, par-delà les considérations politiques, avaient pu favoriser l’extension irrationnelle du conflit jusqu’à lui faire atteindre, par le nombre et la gravité des atrocités commises, les dimensions d’un crime contre l’humanité.
Le réalisateur procède, en premier lieu, au dépistage du réseau de contre-vérités, d’allégations et de phobies ayant enserré, peu à peu, les Etats-Unis dans la logique de l’intervention. Candidement interrogés, certains dirigeants avancent des prétextes géopolitiques absurdes : « Si nous perdons l’Indochine, nous perdrons le Pacifique, et nous serons une île dans une mer communiste. » D’autres voient dans l’intervention une manière de conserver l’accès à des matières premières indispensables : « Si l’Indochine tombait, l’étain et le tungstène de la péninsule de Malacca cesseraient d’arriver. » Les autres, enfin, plus idéologiques, affirment que les Américains interviennent « pour venir au secours d’un pays victime d’une agression étrangère ». Peter Davis sait que, pour élucider les origines de la brutalité dans le comportement individuel des militaires américains, il faut se pencher sur un certain nombre de rites qui caractérisent, en partie, la société.
Hearts and Minds discerne trois de ces rites, ou « structures d’aveuglement », dont la fonction est d’occulter le sens profond d’un acte sous un fatras de significations secondes purement formelles. Peter Davis montre comment, par la multiplication des relais technologiques entre un militaire et sa victime, l’armée parvient à noyer la dimension criminelle d’un acte de guerre.
Ainsi, par exemple, un pilote de bombardier, le regard serein, déclare : « Quand on vole à 800 kilomètres/heure, on n’a le temps de penser à rien d’autre. On ne voyait jamais les gens. On n’entendait même pas les explosions. Jamais de sang ni de cris. C’était propre ; on est un spécialiste. J’étais un technicien. » La conscience du pilote, fascinée par le mythe de la performance technique, néglige de considérer les conséquences de son geste et d’assumer la responsabilité de son action.
Une deuxième structure apparaît en quelque sorte comme le complément de celle-ci : elle consiste à transformer toute participation, dans un domaine quelconque, en une compétition où la fin justifie les moyens. Il importe surtout d’aller au bout de ses forces dans le but exclusif de gagner. Peter Davis compare l’attitude des militaires au Vietnam avec celle des joueurs de football américain. Dans les deux cas, tous les coups sont permis, seule la victoire compte, même si on a oublié les raisons du combat.
Interrogés en pleine bataille dans la jungle vietnamienne, des soldats avouent ne pas savoir pourquoi ils se battent. L’un d’eux est même persuadé que c’est pour aider les Nord-Vietnamiens ! Un officier résume : « Une longue guerre, difficile à comprendre. Mais nous sommes venus pour la gagner. »
Le troisième élément de déculpabilisation est cette sorte de psychologie des peuples - base du racisme le plus élémentaire - permettant de doter mécaniquement les habitants d’un pays de quantité de défauts. Un officier américain raconte aux enfants d’une école ses impressions sur l’Indochine : « Les Vietnamiens, dit-il, sont très retardataires, très primitifs ; ils salissent tout. Sans eux, le Vietnam serait un beau pays. » On y perçoit fort clairement le regret d’une solution radicale (« no people, no problem » ) du genre « solution indienne » que le général William Westmoreland, chef du corps expéditionnaire, a dû être tenté d’appliquer sans scrupules car, affirme-t-il, « les Orientaux attachent moins de prix à la vie que les Occidentaux ».
Peter Davis attribue au conflit vietnamien une valeur de symptôme. Celui d’une grave maladie, à savoir : la violence américaine dont il étudie les caractéristiques militaires, un peu dans le style sociologique qu’avait adopté la réalisatrice Cinda Firestone dans Attica, pour mettre à nu le fonctionnement de la répression policière. Hollywood, qui n’avait pas soutenu cette guerre, n’a pas hésité à récompenser Hearts and Minds d’un Oscar du meilleur documentaire en 1974.
Mais l’oeuvre limite sur les conséquences du conflit dans la trame intime des vies américaines fut Milestones (1975), de John Douglas et Robert Kramer, véritable somme des idées les plus généreuses de la génération qui s’opposa à la guerre. Milestones est une traversée (historique, géographique, humaine) de l’Amérique. C’est la rencontre avec des citoyens conscients que la puissance des Etats-Unis s’est édifiée sur le massacre des Indiens et l’esclavage des Noirs, et qui s’opposent à la destruction du peuple vietnamien. `uvre de renaissance, Milestones marque cependant une coupure assez radicale dans le discours politique.La guerre étant désormais terminée, ce film insiste sur la nécessité de maintenir la mobilisation et prône l’investissement de l’énergie militante dans la vie quotidienne, dans la transformation des rapports du couple, de la famille et de l’amitié.Il souhaite voir s’épanouir une société américaine moins violente, plus tolérante et bienveillante, donnant davantage libre cours à la sensibilité et à l’émotion.
En octobre 1983, enfin, quand l’opinion américaine tentait d’oublier ce conflit, une série documentaire, diffusée par la télévision et intitulée « Vietnam, une histoire télévisée », vint une nouvelle fois rappeler les crimes. Retrouvés par les réalisateurs, deux survivants d’un massacre oublié, celui du village de Thuy Bo, en janvier 1967, se souviennent. M. Nguyen Bai, qui était écolier à l’époque, raconte comment « les "marines" détruisirent tout, abattirent le bétail, achevant les blessés, fracassant les crânes à coups de crosse, tirant sur tout ce qui bougeait ». Mme Le Thi Ton, alors petite fille, confirme : « Nous étions dix dans une paillote quand les soldats américains sont arrivés. Je les ai salués ; ils ont ri et ont jeté une grenade à l’intérieur. Je suis la seule survivante (3). »
A l’heure des repentances, les Etats-Unis regrettent-ils les crimes commis au Vietnam ? Le secrétaire américain de la défense, M. William Cohen, a déclaré le 11 mars dernier, à la veille de sa visite historique à Hanoï, qu’il ne comptait nullement présenter des excuses pour l’attitude des forces américaines durant la guerre du Vietnam.
Ignacio Ramonet.
(1) George Bayley, « Television War : Trends in Network Coverage of Vietnam 1965-1970 », Journal of Broadcasting, printemps 1976, Washington, D.C.
(2) Le Monde, 3 mars 1971.
(3) Lire Patrice de Beer, « Une grande fresque sur le Vietnam », « Leçons d’histoire », Manière de voir, n° 26, mai 1995.